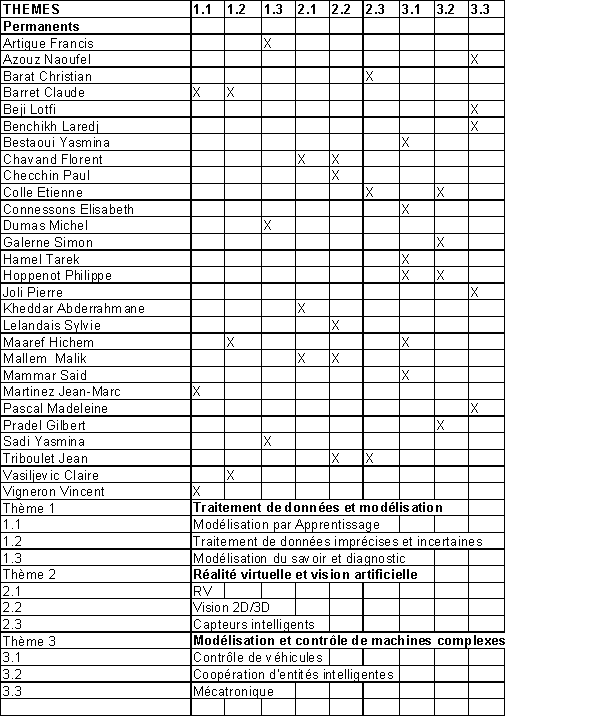
| Accueil • Rapports d'activités • Rapport d'activités 2001 • Annexes |
| Annexes |
Laboratoire Commun de Téléopération et Réalité Virtuelle
Le LCTRV a été créé par convention en Janvier 1999, entre l’UVSQ, l’UEVE et le CEA sur la recommandation du CNRS dans le cadre du projet TRV (Téléopération et Réalité Virtuelle).
Composantes du LCTRV:
CEMIF-SC	Université d’Evry Val d’Essonne		Florent Chavand
STR		CEA, CEN Fontenay aux Roses		Raymond Fournier
LRP		Université de Versailles Saint Quentin	Philippe Coiffet
Objectif scientifique :
L’objectif de cette collaboration est de rassembler une puissance de R&D significative, dans le domaine de la téléopération et de la réalité virtuelle, afin de répondre aux demandes actuelles et futures du secteur nucléaire, mais aussi des autres milieux hostiles, ainsi que des secteurs professionnels et du grand public.
Intérêt socio-économique :
La création de ce laboratoire se fait dans un domaine où l’activité économique est en pleine émergence avec le développement exponentiel des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
Les secteurs industriels concernés sont ceux qui relèvent de ce qu’on peut appeler l’entreprise communicante : télétravail, télémaintenance, télésurveillance, télédiagnostic, téléopération, conception de produits par le prototypage virtuel, assistance au contrôle de systèmes complexes par la simulation et la mise en place d’interfaces homme-machine avancés. Les secteurs socio-économiques concernés sont ceux dans lesquels les techniques de réalité virtuelle sont déjà présentes ou vont se développer.
Les principales applications et activités sont les suivants :
* Interfaces Homme-Machine
- en Robotique d’intervention et de service
Industries des milieux extrêmes, à hauts risques toxicologiques, de radiations, de contaminations ;
exploitation des ressources sous marines, espace, sécurité civile.
- en Chirurgie
* Conception, design d’un produit ou d’un processus de production, Prototypage virtuel :
	Industries mécaniques, biologie et industries chimiques
* Conception et aménagement d’un site :
Architecture, urbanisme
* Exploration de bases de données multidimensionnelles par Interfaces Multisensorielles :
	Industrie pétrolière, etc.
* Simulateurs :
	Entraînement au geste sportif, formation à la conduite de véhicules ou de process industriels, à la maintenance, formation au geste chirurgical, divertissement.
* Présentations 3D interactives (mondes virtuels) :
	Publicité,vente et marketing, divertissement, art, culture, enseignement.
Si le terme réalité virtuelle est à la mode, les activités économiques liés à cette approche sont elles bien réelles.
Selon un rapport du Ministère de l’industrie (1998) le télétravail et le télétraitement emploieront plus de 500 000 personnes en France avant 2010.
Bien que les produits restent pour l’essentiel à créer, il n’y a pas moins par exemple de 205 entreprises en Grande Bretagne déclarant offrir des produits de RV (rapport du ministère du Commerce Britannique, 1997. Ce pays est certes leader, mais seule la France n’apparaît pas dans le concert des pays développés comme un fournisseur. Ce retard est confirmé par le rapport du Sénateur Huriet ( rapport d’information N°169, 1997-1998).
Réalité Virtuelle et Maîtrise des Systèmes Complexes
Université d’Evry Val d’Essonne
Directeur : Florent Chavand, Université d’Evry
La création de ce DEA s’inscrit pleinement dans la politique scientifique des universités d’Evry et de Versailles Saint Quentin, il constitue le volet formation du LCTRV, laboratoire commun entre le CEA, l’UEVE et l’UVSQ. C’est une formation originale dans l’offre des formations françaises qui s’appuie en région parisienne sur un réseau d’écoles et d’institutions de recherche qui représentent l’essentiel des acteurs dans ce domaine. La dimension internationale est soutenue par l’existence d’un Réseau Européen de Recherche et de Formation construit autour de la même thématique. Par ailleurs cette thématique s’inscrit pleinement dans le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication mises au services de la Maîtrise par l’homme des Machines et Systèmes Complexes.
Etablissements porteurs du projet :
sceau principal : Université d’Evry Val d’Essonne – UEVE - , Florent Chavand
établissements cohabilités :
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires – INSTN - , Alain Micaelli
Université de Versailles Saint Quentin – UVSQ - Nacer M’Sirdi, Philippe Coiffet	
Etablissements français partenaires :
ECP – Ecole Centrale de Paris - (Jean Marie Detriché)
ENSMP – Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris – (Brigitte d’Andréa Novel)
ENSTA – Ecole Nationale Supérieure des Techniques avancées – ( ean Louchet)
IIE-CNAM – Institut d’Informatique d’Entreprise - (David Roussel)
INRIA – Institut National de Recherche en Informatique et applications – (Sabine Coquillart)
INT – Institut National des Télécommunications – (Bernadette Dorrizy )
Maquette :
Le DEA se déroule sur deux semestres, le premier est consacré à la partie académique, le deuxième à un stage d’initiation à la recherche.
Partie académique : premier semestre
Tronc commun : 90 heures en 3 modules de 30 heures , enseignement à l’INSTN
Automatique, Robotique (N. M’Sirdi), Vision pour la RV (F. Chavand), IHM et Téléopération	(A. Micaelli)
Cours optionnels : l’étudiant choisi 3 modules de 20 heures parmi les modules suivants :
- Thèmes Automatique ( responsables : Nacer M’Sirdi, Brigitte d’Andrea Novel)
Commande de robots, Robotique mobile, Robots à pattes, Observateurs non linéaires.
- Thème Réalité Virtuelle ( responsables P.Coiffet, P.Fuchs)
Concepts de la Réalité Virtuelle, Interfaces pour la RV, Modélisation pour la RV.
- Thème Perception et traitements de l’information ( responsables E.Colle, F.Chavand)
Apprentissage et optimisation, Vision, Traitements d’information imparfaites, Instrumentation.
ANNEXE 3 : Assistance aux personnes handicapées
DESCRIPTION de l’IFRATH
L’IFRATH (Institut Fédératif de Recherche sur les Aides Techniques pour personnes Handicapées) a été créé sous l’impulsion d’Etienne Colle, d’Alain Pruski du LASC (Professeur à l’Université de Metz) et de Christian Rose (Directeur du service technique de l’AFM). Il regroupe des personnes de compétences complémentaires (automatique, robotique mobile, mécanique, neurosciences, ergonomie cognitive, IHM, CHM, Biomécanique et Handicap, ...). Son domaine d’intérêt s’étend à l’ensemble des aides techniques palliatives.
1. Objectifs
L'introduction des techniques avancées de l'automatique et de l'informatique a permis de générer une nouvelle voie de recherche prometteuse dans le domaine de l'aide technique pour personne handicapée moteur. De plus en plus de personnes commencent à s'intéresser de près ou de loin aux problèmes liés au handicap et les contours d'une communauté scientifique commencent à se dessiner sur le plan national. De nombreux projets européens se développent actuellement avec une présence française très limitée. Il semblerait tout à fait profitable, afin de structurer cette communauté, de créer un groupement de chercheurs pour que nous mettions en commun nos réflexions et nos actions. Pour les chercheurs, plusieurs raisons concourent à travailler dans ce sens. Une structuration de nos travaux permettrait:
En résumé, l’IFRATH a organisé plusieurs réunions thématiques, a permis la mise en place de collaborations entre les membres de l’institut et l’organisation de la première conférence nationale sur les aides techniques " Handicap 2000 " en juin 2000.
Actions en cours, vers une reconnaissance
Des contacts ont été établis avec l’IFRH, réseau reconnu par le CNRS, pour que l’IFRATH constitue la partie " aides techniques " de ce réseau.
Les représentants de l’IFRATH ont été invités par A. Berthoz du collège de France, chargé de mission auprès du ministère de la recherche, afin d’étudier des propositions d’action pour le développement d’un pôle neuro-robotique.
2. Equipes membres de l’IFRATH
ROSE Christian BILLOT Daniel, SKOWRONSKI Jérome
Domaine(s) de compétence: Association représentant les utilisateurs
AFM
COLLE Etienne, HOPPENOT Philippe, GALERNE Simon
Domaine(s) de compétence: Robotique, Téléopération, capteurs intelligents
CEMIF/ Universite Evry Val d'Essonne
PRUSKI Alain, BOURHIS Guy, PINO Pierre
Domaine(s) de compétence: robotique mobile/coopération homme-machine
LASC/Universite de Metz
ROBY BRAMI Agnès, MOKHTARI Mounir, DIDI Noureddine
Domaine(s) de compétence: Controle moteur, Neurosciences, Communicatio homme-machine
INSERM U483/ Jussieu
GORCE Philippe, MIRAMAND Jean Pierre (INSERM)
Domaine(s) de compétence: Biomécanique et Handicap (Modélisation: aspect controle/commande et mécanique, controle moteur) et Cybernétique/Robotique (préhension et bipède)
LPM/LGMPB/IUT de Cachan
Coulon Lauture Françoise, LESIGNE Bernard.
Domaine(s) de compétence: robotique, CHM
CEA/STR
TOULOTTE Jean Marc, CANTEGRIT Brigitte
Domaine(s) de compétence: Communication Enrichie et Palliative (AAC)
Laboratoire d’automatique I3D/Universtité des Sciences et Technologies de Lille
BRANGIER Eric
Domaine(s) de compétence: Psychologie du Travail
Département de Psychologie/Université de Metz
GAILLARD Jean Pierre
Domaine(s) de compétence: Ergonomie cognitive, Interface H/M, Perception visuelle
Laboratoire de psycho. expé/Universite Rennes 2
RICHARDSON James
Domaine(s) de compétence: Ergonomie
LPM/ Université Paris Sud
LEPOUTRE Francois Xavier
Domaine(s) de compétence: Biomécanique
LAMIH/ Université de Valenciennes
MALLET Pierre
Domaine(s) de compétences :
Laboratoire de Neurosciences cognitives/CNRS Marseille
LEPOUTRE Francois Xavier
Domaine(s) de compétence: Biomécanique
LAMIH/ Université de Valenciennes
VIGOUROUX Nadine
Domaine(s) de compétence: Assistance aux handicaps sensoriels
IRIT
ANNEXE 4 : INDEX DES PARTICIPANTS PAR THEME
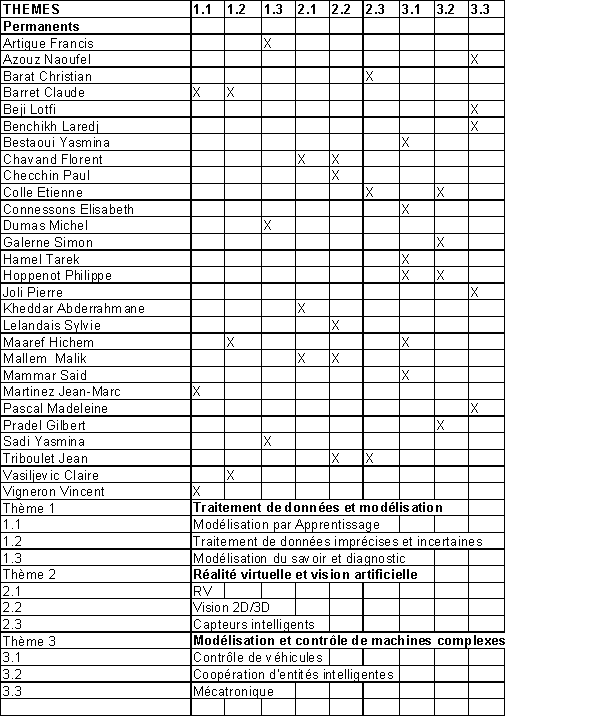
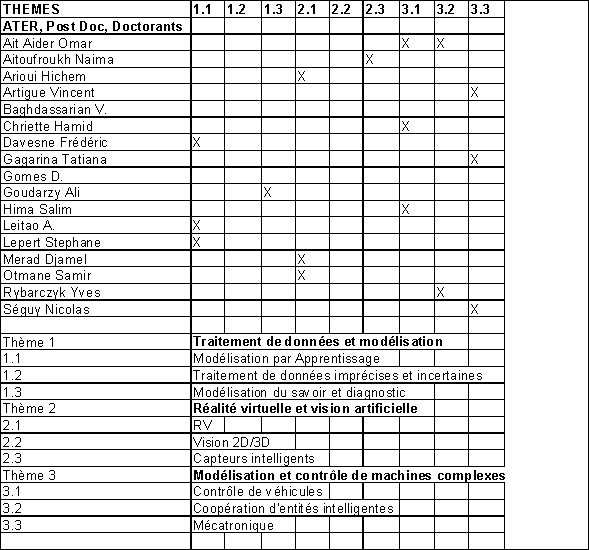
II.3 Déclaration de politique scientifique de l’unité pour les années 2002 à 2005 et équipes composant l’unité
| Libellé de l’équipe (sous-composante fonctionnelle de l’unité) (1) | Responsable | Thématiques et opérations (2) Thème 1 / Thème 2 / Thème 3 |
Effectif équivalent temps plein (3) | Type d’activité (4) |
| Traitement de données et modélisation | Claude BARRET Pr |
Modélisation par apprentissage Traitement de données imprécises et incertaines Modélisation du savoir faire et du diagnostic |
5.66 |
|
| Réalité virtuelle et vision artificielle | Florent CHAVAND Pr | Réalité virtuelle et réalité augmentée Vision 2D/3D |
8.5 |
|
| Contrôle de véhicules et coopération de robots | Etienne COLLE Pr |
Contrôle de véhicules Coopération de robots Capteurs intelligents |
8 |
|
| Mécatronique | Madeleine PASCAL Pr | Modélisation et commande de robots Simulation mécatronique |
6 |
|
II.3. Déclaration de politique scientifique
pour la période 2002-2005
Laboratoire Systèmes Complexes
Projets de recherche pour la période 2002-2005
Au cours de la période 2002-2005, notre effort principal va consister à renforcer la lisibilité du laboratoire en portant notre effort sur les deux axes prioritaires qui devraient devenir nos pôles d’excellence :
Autour de ces deux axes, les deux projets fédérateurs et structurants permettant de regrouper les compétences des équipes de traitement de données, Réalité virtuelle-vision, et robotique sont celui d’Assistance Robotisée à une Personne Handicapée et d’Assistance au geste chirurgical.
Par ailleurs les liens avec les communautés locales, nationales et internationales vont être confirmé ou développés :
Axes prioritaires
A1. Réalité virtuelle et Réalité augmentée
Coordonateur : Abderrahmane Kheddar MCF
Equipes concernées : Thèmes I, II et III
Le laboratoire est engagé dans le LCTRV (Laboratoire Commun de Téléopération et Réalité Virtuelle) - cf annexe 1 - comprenant le CEA-STR, le LRP, et le LSC. Cette activité est soutenue par un DEA Réalité Virtuelle et Maîtrise des Systèmes Complexes ( RVMSC) - cf annexe 2 - porté par notre laboratoire puisque l’Université d’Evry en a le sceau principal.
Les activités vont se développer en synergie avec les partenaires cités ci-dessus, elles concerneront la mise en œuvre des concept de la Réalité Augmentée au télétravail, le télétravail coopératif utilisant les techniques de Réalité Virtuelle et les interfaces multisensorielles (nouvelles interfaces haptiques), la modélisation temps réel, le prototypage virtuel. Un projet de création d’un " cybercentre dans les locaux du CEA de Fontenay aux roses est en cours de montage.
Réalité augmentée pour le télétravail
Nous poursuivons le développement de la télé programmation de tâches de téléopération via internet en l’étendant au travail coopératif. Le travail de groupe supporté par ordinateur ("groupware", CSCW Computer Supported Collaborative Work) connait un développement important. Sa vocation est de permettre à des groupes d'usagers de collaborer en vue de buts communs. Il peut s'agir par exemple de la télé commande simultanée, d'un même robot, qui peut être mobile, par plusieurs co-opérateurs, faisant appel à la compétence de chacun d’eux. La répartition géographique des différents intervenants induit naturellement une dimension répartie.
Par ailleurs, la collaboration repose généralement sur l'utilisation d'objets informatique partagés et pose inévitablement le problème de la cohérence de ces objets et de leur capacité de résistance aux défaillances.
Enfin, cette collaboration est le plus souvent soumise à des contraintes temps réel dans la mesure où elle suppose une réactivité immédiate aux actions des intervenants.
Plusieurs problèmes se posent dont celui du retard de transmission d’informations entre les sites maître et esclave et celui de la précision de la mise en correspondance des mondes réel et virtuel.
Afin de traiter le problème du retard de transmission d’informations entre les sites maîtres et esclave, nous envisageons de procéder selon deux voies complémentaires.
La première consiste à appliquer les outils de réalité augmentée que nous avons développés. L’objectif étant de minimiser le débit d’informations à transférer. Cette minimisation est rendue possible par d’importants traitements, dans les sites maîtres et esclave, et par une sélection judicieuse des informations pertinentes à transférer.
Le site maître sera doté de traitements tels que la reconnaissance en ligne de l’environnement proche du robot, et la prédiction de la trajectoire du robot. La reconnaissance de l’environnement du robot permet d’effectuer une mise en conformité précise des modèles virtuel et réel. Ceci permet d’effectuer une commande de haut niveau du robot. Celle-ci sera soumise dans un premier temps au module de prédiction de trajectoires puis ensuite envoyée au robot réel. Un retour d’effort virtuel devra compléter le module de prédiction de trajectoires.
Le site esclave est équipé aussi d’un calculateur permettant de transmettre, en temps réel au site maître, des informations capteurs minimales renseignant sur l’état du robot et de son environnement et d’effectuer la commande du robot en prenant en compte les consignes issues du site maître. Toutes ces informations capteurs servent à la mise en conformité des modèles réel et virtuel.
Télétravail coopératif utilisant les techniques de la réalité virtuelle
Dans le domaine du télétravail coopératif, Nazim Agoulmine récemment nommé Professeur à l’Université d’Evry, va développer l’étude des environnements multi-agents intelligents distribués dans la mise en place d'un système de télé opération à travers Internet basé sur des outils de réalité virtuelle.
Le développement d'Internet ouvre de nouvelles perspectives dans tous les domaines. Ce réseau permet l'émergence de nouvelles applications telles que le télétravail, le travail coopératif, l'engineering concurrent, multimédia, la réalité virtuelle.
Dés lors, de nouveaux comportements dans le travail vont émerger et influenceront la manière dont les gens se comporteront dans le travail. Le travail coopératif va devenir de plus en plus un atout important dans la gestion des processus de tous types : dans le domaine de la robotique, le domaine de la formation, etc.
Cet axe de recherche a pour but de combiner les apports des systèmes de communication, tels que Internet, ATM et l'UMTS avec les nouvelles technologies de travail coopératif basé sur les agents intelligents et la réalité virtuelle. L'objectif est d'étudier et de concevoir un environnement virtuel d'agents logiciels capable de supporter de manière intelligente l'utilisateur dans un travail coopératif à distance.
L'approche est basée sur des agents qui vont représenter l'unité de raisonnement en interaction avec les utilisateurs finaux. Les agents vont permettre la simplification du travail et la mise en place d'une coopération effective. La recherche d'un formalisme du raisonnement, constituera le cœur de ce travail. L'utilisation de techniques à base de réseaux de neurones et/ou algorithmes génétiques, traités notamment dans le thème I, seront prospectés pour vérifier leurs utilités dans la gestion du réseau et des utilisateurs finaux.
D'autre part, les agents eux même vont évoluer dans un environnement virtuel qui sera conçu à l'aide des formalismes émergeants dans le domaine de la RV. En effet, pour simplifier le travail coopératif; les différents utilisateurs auront une vision virtuelle du monde dans lequel ils coopèrent à travers un ensemble d'agents qui prendront en charge leurs activités.
Des études de cas particulières, sont prises en compte dans cette thématique : la télé opération coopérative dans le domaine de la productique et la supervision de la qualité de service d'applications multimédia coopératives dans des réseaux IP physiques et sans fils.
Cette thématique de recherche développement fait l’objet d’une demande d’un projet européen MUVISHOP ("Integrated MUltimdia system for telepresence-based VIrtual SHOPping") impliquant huit partenaires européens.
L’objectif de ce projet est la mise en place d’un système de téléopération d’un robot mobile via Internet avec comme application le commerce électronique.
Interfaces haptiques
Moyennant des interfaces et des dispositifs ergonomiques adaptés aux modalités sensoriels de l’opérateur humain, l’interaction entre l’opérateur et un environnement virtuel (EV) est voulue à la fois multi–modale (incluant le retour haptique i.e. la kinesthésie et le tactile) et intuitive. Ainsi, l’interaction haptique (i.e. interaction mettant en jeux le sens haptique de l’homme) avec un environnement virtuel rentre dans un domaine plus large que celui de la téléopération. C’est donc tout naturellement que les travaux de recherche dans ce domaine couvrent un spectre d’applications plus large : le prototypage virtuel, la téléopération, les simulateurs interactifs et plus généralement les interfaces hommes machines haptiques.
La problématique théorique posée par ces systèmes concerne à la fois l’informatique, l’automatique et la psychophysique de l’action et de la perception i.e. celle liée aux problèmes de la perception haptique humaine. En effet, il s’agit d’établir les bases théoriques pour l’interconnexion d’un opérateur humain, de nature incertain (i.e. paramètres subjectifs, parfois non mesurables), avec un environnement virtuel, de nature discret, via des dispositifs mécatroniques actifs, de nature continus et non linéaires.
Sur les systèmes à retour haptique il existe actuellement deux voies de recherche :
La voie de recherche choisie est naturellement médiane car plusieurs problèmes traités par l’informatique trouvent facilement une solution dans la commande et vice-versa. Par conséquent, parmi les thésards encadrés par A. Kheddar (responsable de ce thème) l’un (Stéphane Redon) travaille sur les aspects informatiques du retour haptique et l’autre, (Hichem Arioui), travaille sur les aspects purement commande. Les résultats s’orientent vers des socles de ce qui a été baptisé l’infohaptie (par analogie à l’infographie).
A2. Robotique mobile 3D ou aérienne
Coordonateur : Tarek Hamel MCF
Equipes concernées : thèmes I, II et III
Les activités liées à la robotique aérienne ont démarré en 1998 par la création d'un groupe de travail faisant intervenir 4 laboratoires, Heudiasyc (R. Lozano), LAG (B. Brogliato), le LAAS (P. Souères) et bien sur le CEMIF-SC (T. Hamel). Ces activités de recherche existent déjà dans des laboratoires étrangers avec qui nous sommes en contact (ETH Zürich, Monash University (Australie)). Elle est nouvelle en France où nous faisons partie des acteurs de son démarrage.
Après avoir traité les problèmes de la robotique mobile à roues en général, nous nous sommes lancés, dans la commande de systèmes plus complexes. Les robots volants autonomes constituent une préoccupation scientifique plus récente et sont porteurs de nouvelles applications : prise de vue aérienne, surveillance de lignes de haute tension, de trafic urbain, ou d'activité des volcans, traitement et arrosage de cultures, mesure de la pollution de l'air ou de radioactivité, repérage de mines, etc.
Le but de ce projet est de démontrer l'utilité des concepts de l'Automatique pour la commande des robots volants. Il est envisagé que le projet fera une contribution forte au développement et à la mise œuvre d'un dirigeable autonome. En effet, un dirigeable de petite taille (6m de long et 1.5m de large) est disponible au laboratoire CEMIF-SC, depuis janvier 2001. Il assurera que les résultats seront de nature pratique et devront influencer le développement des robots aériens. En plus de cet aspect pratique escompté du projet, nous nous attendons à un impact théorique du point de vue contrôle pour les systèmes mécaniques en général et sous-actionnés en particulier.
Notre projet pour les trois ans à venir s'inscrit dans la suite logique de ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant (cf. section III.1). Il comportera trois volets : l'amélioration des modèles, le développement de techniques de commande et la mise en place d'algorithmes de localisation dynamique et de perception de l'environnement.
Concernant la modélisation
Comme nous l'avons expliqué dans la section III.1, le modèle de l'hélicoptère sur lequel nous travaillons depuis quelques temps maintenant est le modèle dynamique du corps rigides du fuselage auquel nous avons rajouté l'interaction des deux rotors. Ce modèle a le mérite d'être simple. Néanmoins il reste assez loin de la réalité. En effet un certain nombre de phénomènes n'ont pas été pris en compte comme les phénomènes gyroscopiques, la flexibilité des pales ou encore le phénomène lié à la rotation des pales dans le cas de panne ou de baisse de régime moteur. Le travail envisagé s'effectuera en synergie avec l'équipe mécatronique et portera principalement sur la possibilité d'intégrer les phénomènes gyroscopiques et les effets liés à la flexibilité des pales.
Concernant les techniques de contrôle :
Notre intérêt est recentré sur la commande référencée vision pour le déplacement des systèmes sous-actionnès en général, avec une attention particulière pour les hélicoptères et les dirigeables. En référence à ce qui a été mentionné plus haut, cette technique de commande est très récente et mérite qu'on lui accorde beaucoup d'attention. Nous avons un ensemble de primitives référencées vision à mettre en place comme le positionnement par rapport à une cible en utilisant les moments du motif visuel ou encore le suivi de lignes en utilisant leur représentation plückerienne. Sur cette base, Nous souhaitons d'une part, valider les résultats théoriques et d'autre part, prouver que l'automatique est arrivé à un stade de maturité qui lui permet de contribuer fortement au développement de robot régis par des dynamiques très complexes.
Concernant la localisation dynamique et de perception de l'environnement
Les problèmes liés à l'estimation de la position et de l'orientation de l'engin volant sont une extension de ce qui est fait pour les robots mobiles terrestres, sujet dans lequel le laboratoire a une bonne expérience. Cette partie du projet sera exécutée grâce à la participation des membres du thèmes II.3 et III.I.
Programme pour chacun des thèmes
Thème I : Traitement de données et modélisation
Le programme de recherche vise deux objectifs :
Participants : Claude Barret PR, Vincent Vigneron MCF, Jean Marc Martinez DR
Participants : Claude Barret PR, Hichem Maaref MCF, Caire Vasiljevic MCF
La problématique prioritaire deviendra celle de la fusion de données et nous nous attacherons à :
Participants : Francis Artigue PR, Yasmina Sadi MCF, Michel Dumas CR
Ce thème entrera en extinction, M. Dumas rejoignant le thème 1.1 et Y. Saadi devant se rapprocher du thème 3.2.
Thème II : réalité virtuelle et vision artificielle
Projets du Thème II.1 .
Participants : Florent Chavand PR, Malik Mallem PR, Nazim Agoulmine PR, Abderrahmane Kheddar MCF
voir axe prioritaire Réalité virtuelle et réalité augmentée
Projets du Thème II.2 . Vision 2-3D pour la Réalité virtuelle et le contrôle de véhicules:
Participants : Florent Chavand PR, Malik Mallem PR, Sylvie Lelandais MCF, Jean Triboulet MCF, David Roussel MCF
Nous poursuivons l'évaluation des méthodes de reconnaissance automatique d'objet afin d'améliorer leur précision et permettre un suivi d'objet en ligne. L'utilisation des invariants projectifs entre une image et son modèle est l'une des voies à poursuivre.
L’extension du système de reconnaissance aux objets quelconques (éventuellement déformables) nécessite une évolution quant à la modélisation, au traitement d’images et à l’intégration d’autres capteurs (télémètre, stéréo, caméra embarquée sur un robot mobile ou avec zoom, sources de lumière contrôlées, etc.).
Cette thématique de recherche développement fait l’objet d’une demande d’un projet RNTL intitulé AMRA (" Assistance à la Maintenance en Réalité Augmentée ") en partenariat avec ALSTOM TRANSPORT SA et le CEA.
Ce projet vise à apporter aux agents de maintenance, de chez ALSTOM TRANSPORT SA, une assistance en ligne leur permettant d'accéder à des informations pertinentes, à jour, en accord avec la configuration du train.
Le savoir faire acquis dans le domaine de la texture a déjà donné le jour à une application vision en robotique dans le cadre de la thèse d’Humberto LOAÏZA. Ces premiers travaux vont se poursuivre dans le cadre d’un des projets fédérateurs du LSC, à savoir le développement d’une base mobile autonome pour l’aide aux handicapés moteurs. Cette base mobile, qui sera équipée d’un bras manipulateur, doit être apte à se localiser, se déplacer, chercher des objets et les saisir. Ces différentes tâches ne peuvent se faire sans l’aide de la vision. De plus ces différentes tâches doivent être effectuées dans un environnement domestique, naturellement porteurs de textures et de couleurs. C’est pourquoi une études sur l’extraction d’indices visuels dans des images en couleurset/ou texturées démarre actuellement dans le laboratoire.
La collaboration avec l’IMASSA devrait se poursuivre par l’encadrement d’une nouvelle thèse dont l’objectif est de retrouver la signature fréquentielle des objets dans des images. Un tel travail est fondé sur une décomposition en ondelettes des images. Les ondelettes utilisées sont des DOG qui approchent au mieux les fonctions de la vision humaine. L’objectif de cette étude est de trouver des outils permettant d’offrir une meilleure visualisation d’une scène réelle à un pilote. Son contexte est donc la réalité augmentée, problématique proche de la réalité virtuelle qui est une des thèmes forts du LSC. L’avantage de cette collaboration est de travailler avec un laboratoire ayant une grande expérience dans le domaine " psychophysiologie de la vision " qui est indispensable au bon développement d’application de type réalité virtuelle ou augmentée. En effet, présenter des images à un utilisateur nécessite de savoir comment cet utilisateur va voir et comprendre ces images, il est ainsi possible de mettre en avant l’information importante.
Thème 2.3. Capteurs intelligents
Participants : Etienne Colle PR, Christian Barat MCF
Thème III. Modélisation et contrôle des machines complexes
Contrôle de véhicules terrestres et aériens et Coopération entre entités intelligentes
Thème 3.1. Contrôle de véhicules
Participants : Tarek Hamel, Said Mammar, Philippe Hoppenot, Etienne Colle, Yasmina Bestaoui
Localisation d’un robot mobile 2D par caméra ( application à la robotique d’assistance), voir le thème 2.2.
Robotique 3D (robotique aérienne) : voir axe prioritaire correspondant.
Théme 3.2. Coopération d’entités intelligentes
Participants : Etienne Colle PR, Philippe Hoppenot MCF, Simon Galerne MCF, Gilbert Pradel MCF
Dans le domaine de l’assistance robotisée à la personne handicapée ou agée, la coopération humain-machine (CHM) est un point clé qui vise à impliquer la personne dans le déroulement du service que lui rend la machine. En outre, elle permet de réduire les coûts de la machine en limitant sa complexité; certaines fonctions pouvant être à la charge de l’utilisateur.
La CHM repose sur un ensemble d’automatismes disponibles sur la machine. L’autonomie du robot va continuer à être développée dans le cadre du thème 3.1, en collaboration avec le thème 2.2, avec comme objectif la localisation automatique du robot en utilisant une voire deux caméras.
La CHM doit être évolutive en prenant en compte l’amélioration des compétences de la personne dans le temps grâce à l’apprentissage. Dans cette optique nous continuerons à développer des modes de commandes complémentaires et redondants qui permettent à chaque personne d’élaborer des stratégies spécifiques pour réaliser une même mission. La CHM doit aussi être adaptable aux capacités résiduelles et à l’état de la personne. Les modes sont classés en trois catégories, mode manuel, partagé et automatique afin d’offrir la possibilité de stratégies plus ou moins automatiques.
L’existence de ces trois catégories pose le problème de changement de mode pendant le déroulement de la mission notamment quand le contrôle passe de la machine à l’humain, du mode automatique au mode manuel par exemple. L’idée que nous développons pour faciliter ce changement de mode consiste à donner aux opérations automatiques du robot un comportement de type humain (human like behavior). A l’opposé le passage " implicite " du mode manuel au mode automatique peut s’appuyer sur le concept " d’affordance ". (Collaboration avec les laboratoires de psychologie de Rennes 2 et de Valenciennes/LAMIH).
En restant dans le cadre de robotique d’assistance, la coopération entre entités intelligentes va être élargie à un groupe de robots offrant des services distants à la personne. A la CHM s’ajoute un coopération machine machine (CMM) qui reposera sur un ensemble de compétences distribuées sur les machines. A l’aspect décisionnel évoqué plus haut s’ajoutera le degré d’autonomie confié au groupe de robots. L’approche multi-agent adoptée que pour la CMM permettra de décomposer les tâches des diverses entités pour réaliser un objectif commun.
Thème III.3. Mécatronique
Participants : Madeleine PASCAL PR, Naoufel AZOUZ MCF, Lotfi BEJI MCF, Laredj BENCHIKH MCF, Pierre JOLI MCF.
Une activité assistance aux personnnes handicapées physiques se développe dans le groupe mécatronique. Elle a déjà conduit au dépôt d’un brevet ( B00-2 [ART00-B] et à deux autre brevets en cours de dépôt.
* Dans le domaine de la micro-robotique appliquée à la chirurgie, le projet MATEO actuellement en cours se poursuivra sur 5 ans. Le modèle mathématique utilisé sera enrichi afin de recaler les principaux paramètres aux essais effectués sur le prototype développé à l’IUT de Cachan. Ce modèle sera élaboré à partir d’une modélisation éléments finis de l’appareil à l’aide du code de calcul ANSYS et en collaboration avec le Professeur FENG ( CEMIF-Mécanique).
Dans le même temps, la collaboration avec l’Université Simon Frazer et l’équipe du Professeur PAYANDEH pourra s’étendre afin d’aboutir à l’élaboration d’un algorithme optimal permettant des applications en temps réel. D’autre part et en collaboration avec le THEME II (Réalité Virtuelle), on envisage de développer un simulateur pour chirurgien en s’aidant de cet algorithme.
* En robotique mobile, et en collaboration avec le Professeur C. KOZLOWSKI de l’Université de POZNAN, une commande de type adaptatif est à l’étude et pourra faire l’objet d’une implantation sur un robot mobile à roues développé dans cette université.
* En simulation mécatronique, un projet de partenariat entre le CEMIF-SC et la société SINOVIA est en cours de réalisation. Ce projet est destiné à développer des prototypes virtuels par la réalisation d’un banc d’essai comportant un robot de marque FANUC Robotics et de type M6i. Ce banc d’essai permettra de valider les études effectuées sur l’interfaçage d’un automate avec le modèle simulé de ce même robot. Par ailleurs et dans le cadre des travaux de recherche de M. Otmane, nous pourrons également exploiter un tel banc d’essai pour valider cette fois le principe de télé- asservissement et ce en contrôlant le robot M6 i par l’automate et via une liaison de type INTERNET. L’intérêt de tels travaux est de pouvoir offrir à un automaticien la possibilité de valider ces lois d’asservissement sans être obligé de disposer d’une plate-forme robotisée.
* Enfin, en modélisation des robots, plusieurs travaux sont envisagés, notamment en robotique parallèle, où l’élaboration d’un modèle dynamique minimal est à l’étude afin de faciliter l’implantation d’une commande dynamique en temps réel ; En collaboration avec le CEMIF-Mécanique (Professeur FENG), il est envisagé de développer un code de calcul permettant la modélisation, la commande et le suivi de trajectoires pour les robots à composants déformables.
Equipements demandés pour la période 2002-2005
Axe prioritaire Réalité virtuelle et Réalité Augmentée
Interface haptique Virtuose : 300 KF
Table de visualisation grand champ : Workbench-Baron : 1,2 MF
Station de travail Onyx : 1 MF
Lunettes : 100 KF
Capteurs 3D type Polhémus : 50 KF
Station de travail Silicon Graphics () : 200 KF
Axe prioritaire véhicule aérien
Equipement du ballon dirigeable : 220 KF (Capteurs, cartes microinformatiques PC(2), logiciels)
Projets fédérateurs
Bras manipulateur embarqué : 200 KF
Station de travail Silicon Graphics (1) : 200 KF
Lunettes, capteurs : 150 KF
Autres
PC (18) : 180 KF
Logiciels : 100 KF
Total : 3940 KF
Demandé sur contrats et programmes : 2147 KF
Demandé au MEN : 1793 KF